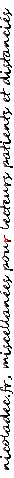|
option musique |
 |
|
| ||
A ssez tôt, vers les huit ans, et sans que personne ne l’eût endoctriné à trouver le juste compte. Vous savez ce que c’est, quand le paquet de bonbons est ouvert, il est vraiment au-dessus des forces du commun des jeunes mortels de s’en tenir à un nombre raisonnable. Le paquet entier y passait inéluctablement, malgré la réprobation souvent clairement explicitée des adultes, et la culpabilité rongeante qui s’ensuivait. L’indignation des grands lui avait cependant rapidement paru assez hypocrite, car il avait bien remarqué qu’ils avaient leur propre version du symptôme, qu’il appelait alors secrètement la dernière cacahuète. Cacahuète apéritive ou bonbon, c’était bien le même piège. La logique en était la suivante, dans son premier degré : je n’en prendrai qu’un nombre raisonnable, disons cinq, puisque dans les deux cas, bonbon ou cacahuète, la chose est réputée mauvaise prise en excès, et notamment coupe l’appétit pour le repas consécutif. Pourquoi cinq ? Parce que c’est un beau nombre, rond et carré à la fois. Rond, car ça tombe juste comme les doigts d’une main, ou comme la juste moitié de la référence décimale qui nous sert de base de numération usuelle. Carré, parce que c’est un nombre impair, et que ça sonne arythmie de bon goût, comme un vendredi qui ne soit pas treize. Mais quel est donc le héros qui, s’étant promis de s’arrêter à la cinquième prise, n’aura pas d’étourderie fatale qui le mènera involontairement à la sixième, voire à la septième ? Et qui ne se dira pas alors que sept est un vilain nombre impair, qui lui ne tombe pas rond, et qu’il est alors plus esthétique, ou plus pythagoricien, enfin plus facile à appliquer comme loi morale, d’aller alors jusqu’à dix ? Mais les marchandises se conditionnent plutôt à la douzaine, et comme treize est un nombre de malheur, surtout si on est un vendredi de mai ou de juillet, de fil en aiguille, ou plutôt de cacahuète en cacahuète, on ne s’arrêtera, de dérapages en ajustements, que quand la pénurie nous y contraindra, quand la coupe ou le paquet sera vide. A ce moment là, à la fois physiquement quelque peu embarrassé par le sucre ou le gras en excès, mais surtout intimement froissé d’avoir une fois encore succombé à sa petite aboulie de détail, on s’en veut secrètement d’avoir encore une fois été vaincu par un misérable petit tas de gourmandises insignifiantes. C’est dans ces moments là qu’on sent se rallumer en soi la flamme salvatrice de l’ascétisme. |
|
C’est là qu’entre en scène le second degré de la logique de l’affaire. Puisque c’est comme ça, se promet-on alors solennellement à soi-même, on ne m’y reprendra plus. Ainsi se fondent les vocations monastiques les plus authentiques. Contre la velléité, une seule arme vraiment efficace, l’abstinence, cette sublime perversion de la volonté qui se dresse contre elle-même pour s’anéantir. Mais l’abstinence radicale est tout de même réservée aux contorsionnistes professionnels : parvenir par l’exercice d’une surpuissance exacerbée de la volonté à la ramener à l’état zéro. C’est beau, mais manifestement réservé à une élite. Alors se fait jour l’admirable réduction dialectique au si peu, souvent même à l’unité pure et simple, autrement subtile que la réduction à rien. Ce qui se traduit sous la forme courante : je n’en prendrai qu’un, un seul bonbon, un seul verre. Pour les cacahuètes, n’exagérons pas de manière invraisemblable, ce ne sera qu’une seule poignée. Et voilà comment, pour ne pas devenir don Juan, on finit monogame. Le peu contre le prou, l’idée paraissait lumineuse dans sa simplicité. Cependant, devant cet unique bonbon, cruellement provocateur par sa présence autorisée, mais solitaire, renvoyant à tous ces autres interdits, il lui avait toujours semblé que ce peu avait inexorablement ce goût si fade du trop peu. Qu’il y avait même un certain sadisme, souvent assumé en masochisme, à goûter une seule fois à ce à quoi on n’aura pas le droit plus avant. Le bonbon unique avait surtout pour fonction de faire mieux goûter l’absence de tous ceux auxquels on n’avait pas droit, pour rester moral, et ne parler que de bonbons. |
Ce ne fut que plus tard, vers les onze, douze ans, que cette aporie de la dernière cacahuète lui apparut sous une occurrence nouvelle. C’était au moment où il avait sérieusement commencé à déconnecter de l’organisation générale ambiante, se sentant bizarre dans ce monde là, dont il avait de plus en plus de mal à bien appréhender les valeurs. C’est à cette époque qu’il avait en effet, par hasard, commencé, à peu près en même temps, à prendre conscience de deux exigences, qui s’étaient alors accolées dans son esprit, dans leur opposition paradoxale. Un homme convenable, entendait-il dire, ne devait aimer qu’une seule femme. Un homme de goût devait être ouvert à toutes les musiques. Mais il lui avait tout de suite semblé avec évidence que les deux propositions étaient intenables, aussi bien parce qu’elles lui semblaient contradictoires entre elles, que parce que chacune lui paraissait contradictoire en elle-même. A cet âge où il n’avait pas encore lu les considérations de Bertrand Russell sur le mariage, car il était encore trop jeune pour avoir eu vent de telles lectures, et né trop tard pour avoir eu connaissance du bonhomme de son vivant, il lui semblait bien que c’était une drôle d’affaire de prétendre n’aimer qu’une seule personne. Et à voir cette tonalité si spéciale qu’il avait plusieurs fois eu l’occasion de surprendre dans le regard de son père, en présence notamment de certaines personnes du joli sexe qui n’étaient pas sa mère, il s’était posé des questions de vocabulaire. Peut-être ne fallait-il pas parler d’amour, puisqu’il n’y en a censément qu’une occurrence à la fois dans la vie d’un homme moralement propre, mais le terme d’émotion semblait pour le moins convenir. Une émotion, une complicité aussi, qui lui avaient semblé parfois avoir l’air assez profondes. Cette manière si spéciale d’avoir l’air d’habiter le même espace, à la fois plus profondément qu’à l’ordinaire, mais aussi plus sereinement, dans la coprésence complètement consentie à l’existence de l’autre, qu’il avait bien perçue chez lui à quelques occasions. C’est vers cet âge là, que par hasard, attiré par ce mystère supérieur des lectures de son grand frère, qui terminait alors ses études littéraires, il avait une fois trouvé un livre laissé ouvert sur le bureau. Il s’agissait d’un allemand, un certain Nietzsche, dont il l’avait déjà entendu parler, sans trop bien comprendre toutefois ces idées qui lui semblaient assez compliquées et un peu confuses. Mais cette fois là, la page était restée ouverte sur cette phrase qui lui avait paru si lumineuse : n’aimer qu’un seul est barbarie, car c’est au détriment de tous les autres. Mais aussi bien, lui venait à l’esprit ce proverbe que répétait sans cesse sa grand-mère , dans les trop fréquentes occasions où elle se croyait encore le devoir de remplir son rôle de vieille mère auprès de son père, il est vrai quelque peu volage : qui trop embrasse, mal étreint. Il lui semblait très évident qu’en la matière, ne s’appliquait pas une logique du tout ou rien, et qu’il ne fallait pas que le trop nous renvoie au trop peu. |
La fidélité absolue d’une part, avec ce détournement de sens qui lui faisait signifier l’unicité synchronique, et le donjuanisme d’autre part, lui semblaient deux comportements énigmatiques, mais heureusement l’un comme l’autre sans doute, plus rêvés que réels. Pour savoir ce qu’on aimait le plus, il fallait avoir goûté à ce qu’on aimait moins, car sinon, comment l’aurait-on su ? Avec le risque évident, mais était-ce bien un risque, qu’on ne parvînt pas vraiment à décider du plus ou du moins. A défaut, n’aimer qu’un seul, ne pouvait guère être, par un refus de s’inscrire empiriquement dans le monde, que se crisper sur la prétendue nécessité d’unicité du choix, c’est-à-dire en dernière analyse, sur la prétendue unicité de son être propre. On n’aimait pas un seul parce qu’on n’aimait que lui, on n’aimait qu’un seul parce qu’on n’aimait que soi. N’aimer qu’un seul, lui avait-il semblé, aurait été réellement n’aimer personne, si ce n’était soi-même, extériorisé dans un autre qui n’y pouvait mais. Mais à l’opposé, aimer tout le monde, aurait encore été n’aimer personne, si ce n’était soi-même dans sa belle compulsion à aimer. A parcourir de manière récurrente les bras semblables des filles, comme le disait cette chanson si souvent fredonnée par son frère, il lui paraissait clairement que des unes aux autres, le séducteur perpétuel ne cherchait rien d’autre que d’y contrôler désespérément sa propre inconsistance. Quant au mépris généralisé sous-jacent qu’on sentait si souvent et si bien affleurer chez tous ceux qui faisaient profession de philanthropie diverse, de solidarité tous azimuts, ou autres onctuosités gluantes de fin de siècle, il lui avait depuis longtemps semblé être l’armature essentielle de l’amour universel. D’ailleurs, il avait bien noté que sa propre mère, archétype en son esprit de toute vertu, pour partisane affichée qu’elle ait été de l’unicité en amour, n’en avait pas moins manifesté une affection apparemment égale sur chacun de ses enfants, affection qui ne semblait pas pour autant en avoir été amoindrie du fait d’être partagée. Pour autant bien sûr qu’il ait été sensé de parler d’égalité pour une chose non mesurable. Et que la même, tout en prônant très chrétiennement l’amour universel, n’aimait manifestement que médiocrement les mendiants, les PDG, les gens bruyants, les femmes séductrices, les athées et les hommes mal rasés, entre autres catégories, et sans entrer dans le détail de cas plus étroitement ciblés. Et puis, il y avait dans ce principe d’exclusivité synchrone, quelques principes implicites qui le surprenaient vraiment par leur inconséquence. |
D’abord, l’application loufoque, mais qui devait plus tard s’étendre encore plus, de l’idée de partage. Dans le cadre d’une éducation saine, c’est-à-dire chrétienne, la sainte personne qui lui avait enseigné le catéchisme, lui avait communiqué ce souci charitable du partage. On évitait par exemple de prendre seul, en égoïste, son repas devant quelqu’un qui ne mangeait pas à sa faim. On partageait. Encore que l’expérience des choses vécues lui avait révélé que l’application pratique de cet impératif moral consistait le plus souvent à veiller de ne prendre son repas qu’en compagnie de comparses suffisamment sustentés. Autrement dit, manger dans le dos des affamés, plutôt qu’en face. Cependant tel qu’enseigné par la catéchumène, d’ailleurs si émouvante dans ses jupes écossaises uniformément tristounettes, et son prosélytisme touchant de naïveté, le principe lui avait semblé déjà plus étrange, car un manteau lui paraissait moins partageable qu’un repas, à condition bien sûr de conserver une exigence minimale d’efficacité. Parler d’amours plurielles en terme de partage ressemblait quelque peu à d’autres idées amusantes d’illogisme, qui s’étaient popularisées par la suite, comme celle, qui connut un certain succès, de partage du temps de travail. On pouvait par exemple bien dire qu’on partageait sa bonne humeur, mais celui qui " partageait " ainsi, ne perdait en principe pas une once de son avoir initial. On aurait même pu dire que le dit partage, loin de diminuer la quantité initiale, si quantité il y avait, aurait plutôt tendance, par un effet synergique, à en épanouir le déploiement. Comme l’on dit que plus on est de fous, plus on rit, il lui semblait qu’au moins jusqu’à une certaine limite, plus on aimait de gens, plus on savait aimer. |
Ensuite l’étonnait cet autre principe implicite et surprenant, qui lui semblait résider dans l’idée même d’exclusivité synchrone, curieusement et généralement dénommée fidélité. Car apparemment, on qualifiait généralement de fidèle, celui qui à chaque époque de sa vie, pratiquait l’exclusivité. Mais on semblait par contre autorisé, du moins depuis que la toute puissance du modèle chrétien de monogamie éternelle s’était considérablement affaiblie, que l’espérance de vie s’était allongée, et que ses conditions sociales s’étaient complexifiées en modèles plus ou moins éclatés, à avoir plusieurs époques dans sa vie. La fidélité, au sens au premier où elle signifiait le fait d’être fidèle, c’est-à-dire dont les sentiments ne changeaient pas, auraient plutôt semblé impliquer qu’on ne cessât pas d’aimer, et donc qu’il était difficile de ne pas compter plus loin que un. Et les sentiments profonds qu’il avait bien reconnus en lui, quand il y songeait sérieusement, par exemple le soir en s’endormant, quand, dans ses divagations libertines, on s’écarte un peu des crispations diurnes de rancune, de jalousie, et autres ressentiments, concernant les quelques filles qu’il avait aimées, lui indiquaient clairement qu’il y avait une belle hypocrisie, sans doute en partie naturelle, dans cette logique, pour être vulgaire, du " un coup chasse l’autre ". Au fond, la dite fidélité, refusant de considérer que quand on comptait un, deux, trois, le premier un était conservé dans le deux, et le deuxième un dans le trois, s’amusait à compter un, un, un, par un curieux dénombrement d’amnésique. Toute personne ayant été quelque peu nomade savait de plus fort bien, pour l’avoir éprouvé intensément, ce qui pour une fois en la matière était une preuve suffisante, qu’on appréciait mieux chaque lieu, quand on n’y était pas condamné à vie. |
Jusqu’à une certaine limite donc, plus on aime de gens, plus on aime. Mais la certaine limite ne devait pas être perdue de vue. Car pour aimer certains, il fallait n’en pas aimer d’autres. Il s’était même dit, en s’inquiétant de l’inimitié profonde qu’il ressentait en lui à l’égard de certains, comme par exemple de la cousine Jeanne, avec ses ignobles petites nattes à prétention jeune, et sa bienveillance aussi gluante qu’indiscrète, que c’était au fond à peu près les mêmes motifs qui pouvaient expliquer son attirance invincible pour d’aucune et sa répulsion pour celle-là. Que celui qui ne savait pas détester ne savait pas aimer, car c’étaient les mêmes choses qui agissaient ici et là, en miroir. C’était à cet endroit que lui semblait étrange cette lubie curieuse qui consistait à se proclamer homme de goût, ouvert sur toutes les richesses du monde, sous la justification d’être capable d’aimer les genres musicaux les plus divers possibles. C’est à ce sujet précis qu’il avait bien saisi à quel point qui trop embrassait nécessairement mal étreignait. Celui qui, à quelque détour de l’adagio du septième quatuor de Beethoven, ressentait, par la beauté absolue de ce désespoir là, qu’il n’y avait besoin d’aucun dieu pour que la vie fût justifiée, que ce monde de toutes les vanités était pourtant le même qui faisait ainsi jaillir en lui cette transcendance qu’on croyait indicible, celui là donc ne pouvait, non seulement ne pouvait, mais ne devait pas aimer le rock. Évidemment, la première fois qu’il avait tenu en public un tel propos, il s’en était inévitablement trouvé un pour réfuter, au nom de sa prétendue expérience propre, une telle alternative. |
Mais que dire contre là, tout était argumentable, même ce qui était impossible. Les cadres de réceptivité qui rendaient une émotion possible, en interdisaient par là même d’autres. Bien sûr, chacun était polymorphe, et donc pouvait être touché de manières diverses. Et il était notable que certains, cependant bien moins nombreux qu’ils ne se prétendaient, étaient capables de grands écarts dans leur émotivité, de distensions mélomaniaques impressionnantes. Il restait que ces divergences, éventuellement prétendues radicales, n’étaient souvent que des anamorphoses. Mais surtout, que croire qu’elles auraient pu diverger à l’infini, sans conséquences oblitérantes, était retomber dans les divagations du prou. On pouvait certes jouer l’amateur éclairé, et, sous couvert de goût, grappiller de ci de là dans des genres hétéroclites, mais celui qui pratiquait sa vie de manière approfondie, il avait coutume d’utiliser l’expression un peu malencontreuse , qui menait sa vie de manière professionnelle, et non en dilettante qui faisait comme si on lui accorderait d’autres essais, comme dans un jeu vidéo, celui qui croyait que la seule croyance justifiable, c’était celle de croire vivre, savait bien qu’à un moment ou à un autre, ceci excluait nécessairement cela, que l’acceptation de telle chose était rédhibitoire à la possibilité de recevoir telle autre. |
Dans ces temps oecuméniques, heureux était donc l’homme qui savait exclure à bon escient. Il avait donc fort bien compris, entre autres, que si l’homme qui n’avait pas d’amis risquait fort d’être un méchant homme, celui qui n’avait pas d’ennemis risquait fort d’être méprisable, ou si l’on veut rester gentil, d’être quantité négligeable. Que tous ceux donc qui lui servaient la sauce de l’universalité, cachaient de bien mauvaises intentions. Aimez vous les uns les autres : qu’on l’entendît de manière chrétienne ou, plus concrètement de manière donjuanesque, c’était une chose aussi malsaine que l’unicité forcenée, si l’on n’y mettait pas les limitations et les contre-épreuves nécessaires. Et puis ce goût de l’universalité était-il jamais autre chose que le refus d’accepter la différence réelle, dans ce qu’elle avait de radical ? Et donc, au fond, n’était-il pas exactement le contraire de ce qu’il prétendait être, c’est-à-dire une réduction à l’unité, autrement dit une réduction à soi-même ? Tel était le dilemme : don Juan n’aimait personne d’autre que lui-même, qu’il détestait d’ailleurs, car toutes ou aucune, c’est du pareil au même. Mais un seul bonbon était plus cruel qu’aucun, et en plus on ne saurait jamais s’il était bon, car pour en juger, il aurait fallu en avoir goûté d’autres. Qu’il lui semblait donc difficile de naviguer entre le trop et le trop peu... |
Il se sentait parfois quelque chose entre dieu et arbre. Dieu aimait également toutes ses créatures, c’était paraît-il le grand message égalitaire de la religion chrétienne. D’insupportables mécréants auraient dit qu’il les aimait toutes, parce qu’il les avait toutes créées à son image, et qu’ainsi faisant, il n’en était qu’à se vénérer lui-même, dans un sublime narcissisme transcendant. Mais enfin, à contempler l’abîme existant entre les prétentions apparentes de la création divine, et la médiocrité effective, pour ne pas dire plus, de sa réalisation de détail, l’exemple de dieu lui paraissait représentatif de l’avoir plus grands yeux que gros ventre, un bel exemple de surestimation des ses moyens. Côté dieu donc, le modèle ne lui avait pas semblé très tentant, on était vraiment dans le trop prou inassumable, à en frôler la faute de goût. Il avait à l’opposé beaucoup d’estime, et disons même d’admiration pour les arbres, pour cette fierté avec laquelle ils se dressaient parfois de leur puissance altière, sans ennuyer personne, affirmation sereine de la puissance qui n’a nulle prétention à un pouvoir quelconque. Plonger puissamment et profondément ses racines dans une terre nourricière, s’y marier de manière si intime à travers sa rhizosphère, qu’il en était bien incertain de prétendre discerner le sien de l’autre, lui paraissait en outre une extraordinaire manière d’exister. Il trouvait cependant désolante leur condamnation à vie de se nourrir de la même terre, au même endroit. Il y préférait de beaucoup sa variante à lui de l’affaire, qui avait justement comme avantage d’être un peu plus variable. Se transplanter de terres en terres, revenir s’enraciner plus fréquemment dans ses terres favorites, s’enrichir des différences et y revenir, sans pour autant s’éparpiller dans la dissolution du trop nombreux. Il fallait pratiquer la juste mesure, trouver le difficile et fragile équilibre de l’optimum, pour saisir enfin cette révélation mieux que divine, et que ne pouvaient soupçonner ni les adeptes du trop, ni ceux du trop peu, que les bras, pas plus que les ventres des filles n’étaient semblables. |
Mais l’amour n’était pas tout, loin de là. Ce ne fut qu’une fois le bac passé, plus honorablement d’ailleurs que certains ne s’y attendaient, au vu de la quantité plutôt minimale d’efforts qu’il y avait engagé, qu’il s’était mis à comprendre sérieusement ce qu’il pouvait en être du travail. Il avait certes antérieurement connu ces périodes plus ou moins stupidement gâchées à bachoter stérilement quelques connaissances fondamentales tant pour sa survie que pour sa santé mentale, sur l’action de la progestérone sur l’hypothalamus féminin, autant que sur le surgissement du dasein ek-sistant laborieusement dans sa gratuité phénoménale au creux de ce bas monde. Mais, à l’époque de leur apprentissage, ces sortes de choses lui avaient semblé ne devoir être importantes que dans quelque dimension encore inconnue de lui, et surtout ne jamais mériter plus que les quelques jours d’affolement préalables à ce qu’on appelait dans le monde scolaire les contrôles. Quand plus tard, il découvrit la passion véritable pour le savoir et le travail, il fit comme tout un chacun découvrant une nouvelle jouissance de vivre. Abasourdi, mais surtout grisé qu’il pût y avoir là tant de plaisir à prendre et à recevoir, il se montra démesuré dans son appétit. Ah, il faisait beau le voir dévorer tous ces sur-mondes et ces sous-mondes réservés aux grands appétits. La philosophie le passionnait, de Philolaos à Keranflech, de Buridan à Lyotard, il lui fallait tout dévorer. Mais il s’était vite rendu compte qu’un auteur ne se pouvait saisir que dans le texte même. Il lui avait fallu reprendre ses vieux rudiments épars de latin, se faire grand commençant de grec, approfondir ses trop faibles compétences germaniques, acquérir les rudiments minimaux de l’arabe classique, et bien sûr devenir pratiquant usuel de la nouvelle langue universelle. Rapidement cependant, ces diverses activités l’amenèrent à vouloir apprendre le maniement d’un clavier, et à acquérir des compétences dactylographiques suffisantes. Lisant Schopenhauer, il comprit qu’il n’était pas possible d’appréhender sérieusement les techniques métaphysiques de résorption de la pluralité, sans avoir un minimum de compétences musicales, et bien qu’un peu âgé pour débuter valablement la chose, il s’enquit d’un violon. Reméditant le message de savoir vivre de nos hommes libres, de Montaigne à Voltaire, il prit au sérieux et au concret la recommandation de cultiver son jardin. L’exigence du mens sanus in corpore sano l’amena, son relatif goût de l’individualisme aidant, à se mettre à l’équitation. Ainsi, de mois en mois, s’alourdissait la tâche immense qui l’attendait pour pouvoir avoir le sentiment suffisant de devenir ce qu’il était. |
Un jour où la dose de café pourtant bien trop forte ne parvenait plus à contrecarrer la submersion, lui vint la question cruelle, que peu osent avoir la lucidité de se poser. Combien de particularités fallait-il donc subsumer sous l’universel, pour finir par croire vraiment à la réalité de l’universel ? La révélation lui vint soudainement, que telle était au fond la seule question qui méritât d’être posée. Et si tout cela n’était qu’ergothérapie inconsciente de sa finitude ? Que pouvait bien vouloir au fond quelqu’un qui travaillait tant ? Il avait bien sûr entendu parler du maniaque qui colmatait son angoisse par le travail, mais c’était là une simple explication psychologique, donc un peu primaire. Plus profondément, celui qui travaillait tant, avait comme prétention inavouée de se réapproprier le monde dans son impossible totalité, même si c’était à travers une appréhension symbolique réductrice plus ou moins rudimentaire. Le grand travailleur avait quelques prétentions à être dieu. Là aussi, il en venait à comprendre et à envier le monomaniaque, bien résolu à n’avoir qu’une seule vocation. Mais la mono quoi que ce soit, c’était toujours la même logique : en avoir juste assez pour mieux souffrir de tout ce qu’on n’avait pas. Qu’il était donc difficile, entre la belle indolence de ses dix-huit ans, et l’énergie désespérée de ses vingt-deux, de trouver le créneau étroit du travail nécessaire et suffisant. |
Sorti encore jeune et de plus brillant diplômé de ses études, il n’hésita que brièvement entre l’inscription dans le petit monde superfétatoire de l’intelligentsia parisienne et le retour aux sources, comme on dit dans ces lieux communs où l’on feint de croire que quelqu’un est nécessairement de quelque part, dans le petit trou perdu où sa mère habitait à l’époque de sa naissance. Désormais un peu plus aguerri au sens de l’entre deux, il sut opter rapidement pour la solution médiane de la métropole locale, du genre sous-préfecture. Mais là bien sûr advint ce qui était sociologiquement inévitable, il devint ce qu’il est convenu d’appeler un notable. Il fut donc rapidement sollicité, de droite, de gauche et d’ailleurs, pour participer à la vie politique locale. Soucieux de ne pas fuir ses responsabilités, il se trouva donc, sans avoir bien suivi le détail de l’enchaînement qui l’y avait mené, conseiller circum-régional sous les couleurs d’un parti d’extrême centre. Ainsi se trouva-t-il mêlé de près à la passionnante gestation de notre bel ordre économique et social, et à l’application hyperbolique mais rigoureuse des lois et règlements, qui sont, comme chacun sait, l’expression concrète de notre liberté. |
Après une première période euphorique, le temps de s’imprégner de la haute valeur philanthropique de sa mission, et accessoirement de goûter aux joies d’autant plus subtiles qu’inavouées du pouvoir, il finit par une pratique peu prisée dans ces milieux, il se posa des questions. Car il lui semblait voir se reproduire la même spirale infernale qu’à son époque de travailleur forcené. Non pas que le travail s’accumulât outre mesure, quoiqu’en prétendissent ses collègues, qui manifestement avaient quelque mal à distinguer le travail de l’agitation, certes plus ou moins fébrile, des réunions, collations, inaugurations et autres fariboles convenues. Mais la surenchère constante des réglementations d’une part, des taxations d’autre part, lui semblaient déraper de manière aberrante. Le principe de base qui voulait que nul ne fût censé ignorer la loi, paraissait bien être la condition sine qua non de toute législation. Une loi qui ne pourrait pas être connue de tous serait donc une loi au moins partiellement occulte, c’est-à-dire une loi potentiellement despotique. Ou bien la loi pouvait être connue totalement de tous, puisqu’elle le devait, ou bien elle était dictatoriale. La multiplication incontrôlée des codes et des lois censément républicains en faisait un ensemble depuis longtemps inconnaissable d’un citoyen quelconque, puisqu’on ne trouvait même pas de professionnel de la chose en ayant une connaissance exhaustive. La loi républicaine était donc à l’évidence dictatoriale, pour cette première raison. Mais il lui revenait aussi, parmi les souvenirs inégalement enthousiastes qu’il conservait de son passage dans les hautes études politiques, ces mots terribles de lucidité prospective proférés par Alexis de Tocqueville, parlant du régime démocratique, et qu’il pouvait encore citer de mémoire : il couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire un jour pour dépasser la foule. |
L’autre côté surréaliste de l’affaire était qu’il fallait désormais savoir plus de choses pour savoir si l’on avait le droit et comment de faire quelque chose, qu’on n’avait besoin d’en savoir pour simplement savoir faire cette chose. Du simple yaourt au spectacle de variété, de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre dans un mur à l’adoption d’un quelconque moyen de locomotion, le mode d’emploi social de n’importe quelle activité comportait désormais plus de droit que de savoir-faire. On parlait alors de bureaucratie, mais cela lui avait paru un diagnostic insuffisant, tel qu’on l’entendait généralement. L’homme politique moyen n’était jamais qu’un don Juan du pouvoir, le grandiose interne en moins, le ridicule en plus. C’est-à-dire un pauvre mortel surestimant ses forces, et accessoirement son intelligence, en s’imaginant qu’il va reconquérir le monde, ou encore mieux le réinventer. Il n’était qu’à voir les délires monumentaux que chacun, à son échelle, exacerbait. Qui n’y allait pas de sa piscine olympique, de son palais régional, de sa bibliothèque nationale, ou de sa belle autoroute ? Chacun sa manière de jouer au petit dieu. Un aspect secondaire, mais néanmoins dérangeant de l’affaire, étant que ces folies des grandeurs, qu’elles soient législatives ou monumentales, se faisaient au détriment de la liberté et du portefeuille du commun des mortels. Il était vain d’espérer un improbable sursaut, car, comme l’avait noté John Donne, ils se croient l’un l’autre et n’entendent donc jamais le vrai. N’aurait-il pas fallu des cours d’initiation préalables pour tout élu, ou pour tout fonctionnaire haut ou moyen, lui enseignant que le plus souvent, small is beautiful, et que trop, c’est trop. |
Ce dérapage du prou avait certes des antidotes divers, mais qui étaient parfois aussi catastrophiques que leur antithèse commune. Il y avait bien sûr la version surannée du la loi, c’est moi. Mais il y avait déjà quelque temps que cette version là avait mauvaise presse. Si elle était encore pratiquée, les potentats locaux n’étant pas vraiment une espèce en voie de disparition, c’était tout de même sous un minimum d’habillage démocratique. Un autre antidote avait nom anarchie, nom synthétique pour des positions assez diverses, mais qui avaient néanmoins plus ou moins en commun le fait d’opter pour le très peu. Mais les déclarations anarchistes ne concernaient généralement que des positions isolées, d’intellectuels ou vaguement tels souvent un peu abstraits, et souvent en grand écart entre leurs positions de principe et leur pratique effective, professionnelle, affective ou autre. Dans le genre variante tortueuse, les protestataires variés qui auraient plutôt été pour le peu concernant la législation qui leur serait applicable, et plutôt pour le prou concernant celle applicable aux autres. Une fois encore, son expérience échouait sur la délicate recherche de l’optimum. |
En toutes choses, il le savait désormais, il y avait un trop peu en deçà duquel il n’y avait pas quantité suffisante, et un trop au delà duquel il y avait excès. Déjà ce trop ou ce trop peu n’était généralement pas faciles à préciser, car les seuils pouvaient en être fort divers, et dépendaient de plus de paramètres divers, dont certains très locaux, très spécifiques à telle ou telle situation particulière. Pour certaines choses, le trop comme le trop peu pouvaient être estimés à un, pourquoi pas zéro ; pour d’autres à plus ou moins de quelques dizaines , pour d’autres à plus ou moins de quelques centaines, pour d’autres encore à plus ou moins de quelques milliers. Mais comprendre de plus qu’entre ces seuils extrêmes, il existait une zone quantitative plus ou moins précise, qui correspondait au mieux qu’on pût espérer, était d’une acquisition difficile, tant pour l’esprit théorique que dans son exercice pratique. Qu’il s’agît du nombre d’aliments divers qu’il était souhaitable d’avoir à son registre alimentaire pour rester en bonne santé, du nombre de livres qu’il fallait avoir lus pour ne pas mourir idiot, du nombre de fois qu’il fallait avoir fait l’amour à l’année pour garder sa lucidité intellectuelle et un système nerveux en bon état, du nombre de codes réglementaires qu'une législation devait comporter pour pouvoir rester un système d’encadrement de la liberté, du taux d’imposition pour que la curieusement nommée justice sociale ne fût ni exploitation de l’homme par l’homme, ni le contraire, du salaire approprié à un emploi donné, se posait la difficile nécessité de dégager la notion d’optimum. S’il était déjà difficile de repérer où commençait l’abus du trop peu, où commençait celui de l’excès, il l’était encore plus de trouver la juste mesure. Mais cette idée, et surtout cette pratique, d’un optimum était beaucoup moins naturelle à acquérir que les autres notions. D’autant que cette recherche se faisait toujours sur fond inavoué de peur des dérives dans les deux sens. Certains avaient sciemment quelques amant(s) ou amante(s) en trop, en réserve surnuméraire pour le cas où quelque autre plus essentielle fût venue à faire défection, comme d’autres avaient dans leurs placards des kilos de sucre en trop en perspective d’une hypothétique guerre annoncée, ou d’autres encore des comptes en Suisse, pour le jour inéluctable où les électeurs se seraient lassés. Mais certains, à l’opposé, veillaient jalousement que nul n’ait plus que le minimum ascétique égalitaire. Haro sur les femmes ou les hommes infidèles, honte à celui qui aurait prétendu travailler plus que d’autres, vidons les poches des riches, et rognons tout ce qui excède. Le nivellement minimaliste est un si beau combat, que nul ne l’arrêtera. |
Il finit néanmoins par être atteint de lassitude devant la vanité des combats politiques. Ces successions de pouvoir qui faisaient que l’hypothétique œuvre des uns était neutralisée par celle des autres, amenaient, comme seul résultat tangible, d’annulations en déformations réciproques, par l’effet de ce que l’on avait appelé jadis une ruse de la raison, un résultat que personne n’avait voulu. Il connut alors son heure néolibérale, considérant que l’enrichissement personnel, quand il n’était pas le fruit trop évident d’une exploitation éhontée de ses contemporains, était encore le meilleur service économique et social qu’on pût leur rendre. Vint alors l’époque prestigieuse des comptes en banques pleins à dégorger, de leur traduction visible pour les profanes, sous forme de voitures puissantes, contenant plus de cylindres qu’il n’était raisonnablement nécessaire d’en avoir pour se déplacer, des résidences trop vastes globalement désignées comme secondaires, enfin de toutes ces choses dont l’énumération eût été encore plus fastidieuse qu’indécente. Il comprit à cette époque que la difficulté d’être riche ne consistait pas tant à trouver des revenus suffisants, qu’à trouver des dépenses suffisantes. La dépense somptuaire devint son triste quotidien. Qui saura dire la lassitude de devoir prouver jour après jour, pour la galerie aussi bien que pour soi-même, qu’on est à la hauteur de son prestige, et de ne même plus avoir ce droit fondamental, qui mériterait d’être inscrit dans la déclaration des droits de l’homme, le droit à manquer de quelque chose ? Seuls ceux qui l’ont vécu, peuvent comprendre ce qu’est l’angoisse de ne pas parvenir à trouver quoique ce soit dont on puisse dire : je ne peux pas me le payer. Tout devient alors fantomatique, dans l’absence du refus nécessaire à sa consistance. |
C’est alors qu’on se sent devenir l’âme franciscaine, et, qu’en souvenir illusoire des joyeux temps, du moins a posteriori réputés tels, de sa vie estudiantine, on en contracte la nostalgie des voeux de pauvreté. Mais connaissant trop bien les illusions rétroactives de la mémoire, et ayant quotidiennement sous les yeux quelques exemples contemporains laissant supputer le caractère plutôt désagréable de la véritable pauvreté, il n’eût garde de reprendre une pratique réelle du trop peu. Mais il comprit enfin, à travers cette douloureuse expérience de la richesse, comment le quantitatif pouvait dégénérer en qualitatif. Le trop peu dégénérait en cruelle pénurie qui se savait telle. C’était quelque chose de beaucoup plus dur que de simplement ne pas avoir assez. Trop peu à manger, trop peu d’amour, trop peu d’argent, trop peu de considération, trop peu de sexe, ce n’était pas simplement du manque, c’était de la détresse. Celui dont la température descend à trente degrés a souvent autre chose comme problème qu’une température insuffisante. Mais à l’inverse, en s’approchant de quarante degré, on n’a généralement plus comme problème principal d’avoir trop chaud. Le trop se délitait quant à lui dans la fuite désespérée vers l’impossible dépassement de sa propre finitude. Car dans l’un et l’autre cas, c’était bien de cela qu’il s’agissait. Si petit dans ce monde trop vaste, si ambitieux eu égard à cette petitesse, il se sentait ce pauvre roseau pascalien, grandiose et ridicule à la fois. Comment faire, modeste objet fini, pour exister en tant que soi-même, se délimiter clairement dans une cruelle unicité restreinte, ou se dissoudre perpétuellement dans une quête sans fin ? |
Fallait il n’avoir qu’un seul enfant, au risque de contribuer à répandre le modèle de l’affreux petit chéri à sa mémère, infect jusqu’au bout de la tranquille assurance que lui confère son statut de petite unicité locale, incapable à jamais de s’ouvrir aux aléas du vaste monde ambiant ? Fallait-il au contraire se la jouer chrétienne, belle grande famille unie, dont le consensus affiché cache parfois bien mal à qui veut y regarder de près, la solidité des haines d’autant plus viscérales que très tôt générées ? Faut-il ne conserver par-devers soi que les trois ou quatre livres qui auront véritablement marqué sa carrière de lecteur ? Ou fallait-il, se préservant du monde par ses écrits , se barricader d’étagères entassant tous ces livres qu’on aura possédés à défaut de les avoir lus, symboles mythiques de la profusion des mondes qui auraient pu advenir, des vies qu’on aurait pu vivre ? Ou encore adopter la variante strictement unicitaire, dans sa froideur glaciale de meilleur des mondes : le coran à la place de la bibliothèque d’Alexandrie, la bible comme unique contenu culturel d’une chambre d’hôtel américaine, ou encore le capital dans la variante matérialiste prétendument dialectique de cette monomanie ? Comment choisir, entre le rigorisme du trop peu, insoucieux de la souffrance qu’engendrait sa tyrannie, peut-être même goûtant parfois suavement la détresse inhérente aux infirmités qu’il imposait, et l’inachèvement dissolvant de la quête sans fin, inconscient du mal qu’il répand à son insu, ne laissant derrière lui que des terres brûlées ? Les professeurs de sagesse, qui, comme leurs collègues des autres disciplines, s’évertuaient à enseigner aux autres ce qu’ils étaient incapables de produire eux-mêmes, avaient beau jeu de nous convier à la juste mesure, de nous apprendre l’éthique du juste milieu. Car bien malin aurait été celui qui eût su y repérer un milieu, aussi hypothétique que le centre du monde auquel on croyait jadis. L’existence ne lui semblait vraiment pas avoir de centre, pas de milieu, et encore moins une quelconque position qu’on eût pu qualifier de juste... |
Il vécut centenaire, ce qui lui causa bien des soucis. Les arrangements et les dénombrements, dont on aura mis toute une vie à acquérir une certaine pratique, pour lesquels on aura dépensé tant d’efforts et de souffrances pour parvenir à de fragiles équilibres, se décomposaient alors. Un succession d’implosions diverses, ponctuaient de longs effritements, compensés il est vrai par de regrettables augmentations incontrôlables, comme celles des maux divers, physiques et mentaux. Passé la soixantaine, il avait commencé à ressentir une certaine indifférence à l’égard de l’état de ses richesses matérielles, ou plus exactement à l’égard du devenir de leur accroissement. Quand il devint octogénaire, il se surprit à trouver moins crucial le nombre de corps féminins dont il pouvait disposer. Certes il avait encore en mémoire ces temps récents où il gardait l’obsession de ces peaux douces et lisses, fermes et chaudes, dont naguère encore des jeunes filles intéressées laissaient profiter ses mains pourtant déjà rugueuses. Mais il avait finit par prendre en grippe, puis en dégoût, la perfection insolente de ces surfaces imméritées. La décrépitude avancée de sa propre peau, si injustement et inexorablement irréversible, lui avait progressivement interdit de conserver un quelconque intérêt pour cette cruauté insouciante des beaux corps. Il crut d’abord en conserver une certaine nostalgie, mais du se rendre à l’évidence que ce n’était plus guère, à l’usure, que de la nostalgie elle-même dont il avait nostalgie. Il saisit de plus en plus cruellement la justesse de cette fameuse formule, la vieillesse est un naufrage. Mais il notait aussi à quelle point elle était incomplète. Les acteurs d’un naufrage étaient généralement d’accord pour qu’on suspende les opérations. Mais les hommes vieillissant ne l’étaient pas nécessairement. Moins la vie tenait à vous et plus on y tenait. Car plus fort que l’horreur de vieillir était le refus de mourir… Et cependant, il le faudrait bien , tôt ou tard. Là encore, se posait l’inextricable question de l’optimum. Aurait-il fallu en temps utile, à l’instar de cette longue dame brune, prétendre qu’à mourir pour mourir, il fallait choisir l’âge tendre ? Ou, comme à présent, dans ce peu de présent qui lui restait, connaître ce plaisir serein mais profond de la lecture des avis nécrologiques de ses contemporains, où l’on constate jour après jour que l’on a fait mieux qu’eux, éprouvant de ce fait la jouissance profonde d’une justice totalement imméritée ? Était-il bête de mourir trop jeune, était-il bête de mourir trop vieux ? N’était-il pas absurde, insupportable même, d’avoir toujours compris trop tard ? Car c’est quand on meurt enfin qu’on comprend comment il aurait fallu vivre. Peu ou prou, restait ce secret scandaleux que nous tentions de nous cacher à tout prix, non pour ne pas nous affliger, mais pour pouvoir mieux nous mentir sur le sens de toute cette affaire, pour vouloir croire coûte que coûte à l’équité possible d’une juste mesure : qu’un homme était assez vieux pour mourir, du jour qu’il était né. |
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes pouvant valoir le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220610 |