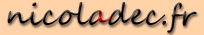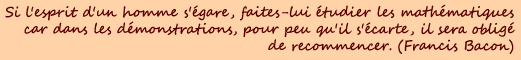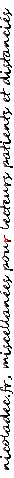|
option |  |
|
|
Survoler les mots en bleu avec la souris |
Le pythagorisme, état théologique
L'œuvre et la vie de Pythagore de Samos, philosophe et mathématicien du VIième siècle avant notre ère, nous est mal connue. Il ne nous reste aucun écrit de lui, et il nous est difficile de discerner ce qui proviendrait de lui personnellement, et ce qui proviendrait de ses disciples, formant ce qu'on appelle l'école pythagoricienne. Les tables de multiplication, le système décimal, le théorème portant de nos jours son nom (sur le carré de l'hypoténuse) sont d'origine pythagoricienne. Philolaos, de l'école pythagoricienne, affirmait la sphéricité et la rotation de la terre. Mais leurs grandes découvertes mathématiques (qui peuvent paraître banales de nos jours, mais qu'il fallait inventer), ont amené les pythagoriciens à concevoir une théologie et une philosophie mystique basées sur les mathématiques. Le pythagorisme, partant du constat que le réel se mesure, donc s'appréhende avec des nombres, en conclut que les nombres sont les principes de toutes choses. Le nombre est intermédiaire entre dieu et la création. On pourrait résumer sous la forme : le monde et combinaison de nombres, les nombres sont combinaisons à partir de un, donc un (il faudrait écrire "Un") est le dieu créateur du monde par l'intermédiaire des mathématiques. Faire des mathématiques est donc un acte religieux. Aussi l'enseignement pythagoricien avait un caractère initiatique, et comprenait la croyance en la métempsychose. Il y eut des communautés pythagoriciennes, au mode de vie ascétique. Le pythagorisme comporte une mystique des nombres, leur attribuant une valeur symbolique. Les nombres pairs sont réputés être femelles, et les impairs mâles. 1 est Zeus, 2 la femme, 3 l'homme ou la puissance. L'arithmétique devient alors combinatoire symbolique, 2 (femme) + 3 (homme) = 5 (le mariage). Il faut comprendre que là où nous considérons qu'il y a mélange de deux domaines différents, l'un mystique et religieux, l'autre proprement mathématique, les pythagoriciens ne pensaient pas qu'il y avait mélange de deux activités, mais pratiquaient l'ensemble comme une seule démarche cohérente. |
|
L'esprit du pythagorisme a largement survécu à travers les siècles. D'une part, le pouvoir irrationnel des nombres reste très fort (pourquoi attribuer plus d'importance au passage à l'an 2000 qu'à celui à l'an 1997 ?). Au niveau des croyances populaires leur valeur mystique et parfois transcendante joue encore un grand rôle (voir les vendredi 13, la numérologie, les gens qui jouent au loto leur date de naissance, etc.) D'autre part, de nombreux scientifiques à travers l'histoire des sciences sont restés très proches du credo pythagoricien, comme Galilée put le formuler : " La philosophie est écrite dans ce grand livre qui continuellement est ouvert devant nos yeux, moi je dis l'univers, mais on ne peut le comprendre si tout d'abord on n'apprend pas à connaître la langue dans laquelle il est écrit. Il est rédigé dans une langue de mathématicien et les caractères sont des triangles, des cordes et d'autres figures géométriques." (L'essayeur).
La grande aventure du postulat d'Euclide
Euclide prétend présenter la géométrie comme un système, donc comme un ensemble où chaque proposition est liée à toutes les autres. Tout, à l'intérieur de ce système, doit être démontré (ce qui correspond à la notion de théorème),
et il n'est bien sûr pas question de faire appel à un fondement surnaturel ou théologique. Mais il y une difficulté de fondement avec la notion de démonstration. En effet, celle-ci ne peut être effectuée qu'avec l'aide d'autres théorèmes, qui doivent à leur tour avoir été démontrés. Mais pour démontrer ces derniers, il va falloir faire appel encore à d'autres théorèmes qui etc. On comprend alors que s'esquisse un mouvement en arrière qui n'a aucune raison de s'arrêter et qu'on appelle régression à l'infini. L'homme étant un être fini, pas susceptible d'entreprendre une telle régression, il lui va bien falloir commencer, donc commencer par quelque chose de non démontré. Par quoi l'on voit qu'il n'est pas si facile de se passer d'un fondement théologique. Euclide va donc partir de propositions non démontrées, qu'il demandera (en latin postulare) au lecteur d'accepter sans démonstration, et qu'on
appelle donc des postulats. Comme il n'y a pas de raison qu'on accepte comme vraie une proposition non démontrée, on va asseoir ces postulats sur un autre fondement, l'évidence intuitive. On pourra d'ailleurs reprocher à Euclide d'admettre certains postulats implicitement (par exemple celui selon lequel un déplacement ne déforme pas une figure). Les postulats comportent donc un présupposé épistémologique, celui que la géométrie serait l'étude d'un espace réel, dans lequel on pourrait en conséquence se permettre de vérifier expérimentalement les propositions
non démontrées.
Euclide va avoir un petit problème avec sa vingt-neuvième proposition, pour laquelle il est obligé de demander au lecteur d'admettre un nouveau postulat. Pour démontrer que la somme des angles d'un triangle est égale à 180°, on trace par un sommet la parallèle au côté opposé. Du fait de l'égalité des angles alternes internes, cette parallèle est porteuse des trois angles du triangle, donc la somme de ceux-ci est de 180°. Mais il y a quelque chose qui reste implicite dans cette démonstration. Pour se baser sur une construction, il faut établir la possibilité et l'unicité de cette
construction. Est-il toujours possible de mener une parallèle à une droite passant par un point extérieur à cette droite ? Ne peut-on en mener qu'une seule ? Intuitivement, on tendrait à répondre oui aux deux questions. C'est cependant incertain, pour la simple raison que la notion de parallèle ne peut être exactement
intuitionnée, la définition de telles droites (dans un même plan) étant que, bien que non confondues, elles ne se coupent jamais. Il faudrait pouvoir poursuivre à l'infini pour être sûr qu'elles ne se coupent jamais, ce qui est donc en dehors des possibilités de notre expérience. Le postulat selon lequel par un point pris hors d'une droite, on peut mener une parallèle et une seule à cette droite, n'est donc pas de même nature que les autres postulats, non démontré, non complètement intuitif, il n'est donc pas acceptable pour les puristes. La forme exacte (équivalente à ce qui précède) de ce cinquième postulat est : " Si une droite, tombant sur deux droites, fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces droites, prolongées à l’infini, se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits."
Pendant vingt-deux siècles, les mathématiciens alexandrins, arabes, européens, tentèrent en vain de démontrer ce postulat sur la base des autres, car cette impuissance était ressentie comme une tache originelle, fragilisant la validité des mathématiques. Au dix-neuvième siècle, un russe, Lobatchevski, reprend une tentative du dix-huitième siècle, pour le démontrer par l'absurde. L'idée est qu'en prenant comme point de départ l'hypothèse selon laquelle par un point pris hors d'une droite, on peut mener plusieurs parallèles distinctes à cette droite, plus les autres postulats d'Euclide, on devrait arriver à des contradictions, qui prouveraient donc que cette hypothèse n'était pas recevable. Or ce n'est pas du tout ce qui arrive. On construit alors une autre géométrie, aux théorèmes certes bizarres par rapport à nos habitudes perceptives, mais ne comportant aucune contradiction interne. La somme des angles d'un triangle y est par exemple toujours inférieure à 180°, et est d'autant plus petite que le triangle est plus grand. Lobatchevski parvient donc à l'opposé de l'objectif initial, il construit une nouvelle géométrie (celle d'un espace qu'on dira à courbure négative). Emboîtant le pas, Riemann construit encore une autre géométrie, en niant l'existence des parallèles, et en refusant le premier principe d'Euclide selon lequel par deux points différents, on ne peut faire passer qu'une seule droite. Cette géométrie a également des propriétés non conformes à notre représentation, la somme des angles d'un triangle y est toujours supérieure à 180°, des droites distinctes dans un plan s'y coupent deux fois. Cette géométrie correspond à ce qu'on appelle un espace à courbure positive. On se retrouve donc dans le cours du dix-neuvième siècle avec trois types différents de géométries. La tendance générale est alors d'estimer que l'une est la vraie (celle d'Euclide), et c'est effectivement la seule pour laquelle on peut se représenter les figures, et que les autres sont des sortes de géométries imaginaires (c'est d'ailleurs ainsi que Lobatchevski appelle la sienne), des constructions de la raison pure, dont on sait, depuis Kant, qu'elle peut inventer à loisir.
Ce que d'aucuns appelleront le préjugé réaliste résiste donc très bien à ces nouvelles découvertes, dont on n'a alors pas encore pris toute la mesure. Mais un certain nombre d'événements scientifiques vont battre en brèche cette position que l'on pourrait qualifier de "métaphysique". D'abord, entre espace à courbure négative et espace à courbure positive, on comprend que l'espace euclidien correspond au cas de l'espace à courbure nulle, il n'est donc qu'un cas parmi les autres. Henri Poincaré va montrer qu'on peut se représenter le plan riemannien en le "traduisant" dans notre représentation par la surface de la sphère. Les droites deviennent ainsi les grands cercles de la sphère (c'est-à-dire les cercles sur la surface ayant comme centre le centre de la sphère). On "voit" alors bien que deux droites distinctes se coupent en deux points distincts, que la somme des angles d'un triangle (on appelle cela en géométrie euclidienne des triangles sphériques) est toujours supérieure à 180°, etc. Si l'on peut trouver un modèle représentatif du plan riemannien, c'est qu'il n'est pas si imaginaire que cela. Enfin, on remarquera ultérieurement que la théorie de la relativité généralisée (qui introduit justement en physique la notion d'espace courbe) peut avec profit s'exprimer en géométrie riemannienne. On en arrive ainsi à l'idée que l'une n'est pas plus "vraie" que l'autre, qu'il s'agit de systèmes différents, qui peuvent s'avérer plus ou moins pratiques selon le type d'utilisation envisagé, ce qui change radicalement le statut ancien des mathématiques comme expression du réel.
L'axiomatique
Les mathématiques doivent donc être conçues, selon l'expression de Poincaré, comme une science "hypothético-déductive", d'où la célèbre boutade : "Les mathématiques sont une science où on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai" (Bertrand Russell. On n'affirme plus désormais la vérité des points de départ, on ne prétend rien de plus que le fait que ce soient des points de départ. On renoncera en particulier à la distinction classique entre des postulats (qu'on demande d'accepter, si possible sur les bases d'une "évidence" empirique et des axiomes (qui seraient des sortes d'évidences logiques, comme le principe selon lequel le tout est plus grand que ses parties, voir ci-dessous sur l'infini). On appellera donc d'une manière générale axiome tout "acte décisoire de l'esprit au début de la déduction". Pas décisif hors de l'état "métaphysique", l'axiome ne définit pas une notion, mais une règle opératoire (on ne prétend donc pas par là désigner quelque chose, un objet, mais un procédé, un acte de la pensée.) Les axiomes ne sont donc en eux-mêmes ni vrais, ni faux. Ce sont les théorèmes qu'on en déduira qui pourront être qualifiés de vrais, mais seulement par rapport au système basé sur ces axiomes. Il n'y a donc plus de vérité mathématique absolue, mais uniquement à l'intérieur d'un système, ce qui représente donc une
conception de la vérité fort éloignée de l'idéal philosophique classique du même nom.
On appelle axiomatique le système d'axiomes constituant la base d'un système mathématique. D'une manière plus large, on appelle aussi ainsi l'ensemble des "bases" nécessaires, ce qui comprend, outre les axiomes, la définition des signes utilisés (ce qu'on pourrait appeler le vocabulaire), et les règles de combinaison de ces signes (les écritures qui sont licites et celles qui ne le sont pas, qu'on peut donc appeler la syntaxe). Il existe dès le départ deux problèmes avec les axiomes. Il est d'abord préférable qu'aucun ne puisse se déduire des autres (sinon, il faut en faire un théorème), on appelle cela leur indépendance. Ensuite, il faut évidemment qu'ils soient compatibles, c'est-à-dire non contradictoires entre eux (on appelle cela consistance du système). Cette dernière exigence est fondamentale, car, du fait de la définition de l'implication (voir leçon sur la logique), un système contradictoire permet de déduire n'importe quoi, aussi bien une proposition que son contraire, et n'a donc aucun intérêt. Mais elle n'est pas nécessairement facile à vérifier. Si ainsi on prenait simultanément comme postulats le postulat d'Euclide et le fait que la somme des angles d'un triangle soit inférieure à 180°, rien n'indique à première vue qu'ils soient contradictoires (ils ne parlent apparemment pas de la même chose), et pourtant ils le sont.
La logique binaire se contente de reconnaître deux valeurs, le vrai et le faux. Or, il peut exister des propositions douées de sens, et dont on ne peut ni établir la vérité, ni établir la fausseté. Il peut même être possible de démontrer que certaines propositions ne peuvent être ni démontrées, ni réfutées. Elles sont alors dites propositions indécidables. En toute rigueur, il peut donc y avoir dans un système trois types de propositions, les vraies, les fausses et les indécidables. On parle d'incomplétude pour qualifier un système dans lequel existent des propositions indécidables. Kurt Gödel montre à partir de 1930, dans de fameux théorèmes portant sur l'incomplétude des systèmes, que pour tout système vérifiant certaines conditions minimales, la consistance ne peut être établie qu'en faisant appel à des mécanismes déductifs non formalisables dans le système. Autrement dit, aucun système ne peut, par ses propres moyens, établir sa propre validité. On peut formuler cette difficulté en disant qu'aucun langage ne peut contenir son propre métalangage. Il faut saisir l'immense portée philosophique de ces découvertes mathématiques. On serait tenté de dire, pour parler le langage d'Auguste Comte, que les mathématiques atteignent ainsi l'âge positif. Car en montrant la coexistence de systèmes contradictoires, en établissant l'impossibilité d'une autojustification de tout système, en montrant l'existence de propositions indécidables, elles fondent le renoncement à une notion de vérité absolue.
La nature des objets mathématiques
D'où proviennent les objets mathématiques ? Selon les thèses empiristes, ils sont issus, comme toute autre connaissance, de l'expérience. Selon Stuart Mill, " (...) les points, les lignes, les cercles que chacun a dans l'esprit sont de simples copies des points, des lignes, des cercles qu'il a connus dans l'expérience." Ainsi la lune et le soleil nous mèneraient à l'idée de cercle, la surface du lac à celle de plan, le fil à plomb à la droite, le tronc d'arbre au cylindre, etc. Il y a cependant d'importantes difficultés dans cette thèse. D'abord, les formes géométriques élémentaires sont plutôt rares dans la nature, qui nous propose au contraire des formes
assez déroutantes et complexes, et il faudra des travaux comme ceux de Mandelbrot, avec les formes fractales, pour commencer à en rendre compte. Ensuite, il faut tellement de bonne volonté pour aller du tronc d'arbre au cylindre, qu'on peut légitimement se demander si on ne se contente pas de retrouver dans le tronc d'arbre l'idée de cylindre avec laquelle on l'a préalablement appréhendé (car là aussi, une courbe fractale conviendrait mieux). Quant à parler de "simple copie", la moindre réflexion sur les objets mathématiques élémentaires rend la qualification peu probable.
Une droite, un plan, un point ne peuvent pas exister dans une expérience réelle, faute d'épaisseur. Une droite sans épaisseur ne pourrait être donnée que comme limite entre deux couleurs, mais la couleur n'intervient pas dans la définition des figures géométriques. On ne voit pas ce qui dans le réel pourrait mener à la notion de nombre négatif. Ce qui existe existe, positivement donc. Et si l'on dit que l'expérience peut nous y conduire, par ce qui y manquerait, il faut alors se souvenir que ce qui manque ne manque que par rapport à une attente, donc c'est la pensée qui met le négatif. Le nombre même, qui repose
sur l'unité, a ainsi une base bien peu réelle, car il n'y a guère d'unité stricte dans le réel, là aussi, on peut plutôt soupçonner la reconnaissance a posteriori des traces d'un acte de la pensée (voir sur le problème des nombres, Le nombre et les nombres d'Alain Badiou, et sur l'ensemble du problème, Mathématiques et réalité.)
Platon, mettant en scène la fausse naïveté de Socrate, le place devant cinq osselets. Qu'y a-t-il vraiment de donné quand on a devant soi cinq osselets ? Il y a osselets, et il y a cinq. On peut toucher les osselets, ils sont bien là, concrètement, mais pas en tant que cinq. Car chacun existe en lui-même, dans l'indifférence du nombre qui permet de lui en associer d'autres. Mais où est alors le cinq ? Il n'existe pas de la même manière que les osselets existent, il est une pure idée. Le mathématicien ne s'occupe pas des osselets, il s'occupe du cinq, il a donc quitté le monde sensible pour accéder à celui des idées. L'espace du géomètre n'est pas l'espace sensible, il n'est pas l'étendue concrète où rien n'existe sans épaisseur, mais une étendue intelligible. Il ne faut pas confondre les figures et les objets mathématiques qu'ils figurent. " Le géomètre, lorsqu'il trace au tableau ses figures, forme des traits qui existent en fait sur le tableau qui
lui-même existe en fait. Mais pas plus que le geste physique de dessiner, l'expérience de la figure dessinée en tant qu'expérience ne fonde aucunement l'intuition et la pensée qui portent sur l'essence géométrique" (Platon, mettant en scène la fausse naïveté de Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie). On parlera alors d'une idéalité des objets mathématiques.
Concernant la nature des objets mathématiques, les thèses opposées de l'empirisme et de l'idéalisme reposent néanmoins sur une conception commune, à savoir qu'il existe bel et bien de tels objets, donc préexistant à leur découverte. Mais on peut mettre en doute qu'il y ait objet. Le langage naturel nous montre déjà cette possibilité de substantivation, d'hypostase, qui consiste à transformer en substance ce qui est acte (Le passage du cortège : passage ne désigne pas "quelque chose", mais un acte). De la même manière, les prétendus "objets" mathématiques ne peuvent être que des abstractions opératoires. Le cinq n'est ni dans les osselets, ni dans un ciel intelligible. Il n'est nulle part, parce qu'il n'est pas quelque chose, mais une opération de l'esprit, qui décide de considérer ensemble ces osselets-ci et non les autres. L'objet mathématique est "substantivation" d'une opération. Celle-ci prend plus de puissance à mesure qu'elle prend plus d'extension, donc plus d'abstraction, ce qui veut dire moins de concrétude. L'illusion (commune sans doute à toutes les sortes de langage) consiste donc à dénommer comme être ce qui n'est qu'opération sur des êtres. On retrouve donc ici une critique proche de celle du nominalisme.
La science transcendantale
Comment les mathématiques, dont les objets ont des caractéristiques rendant impossible leur existence physique (comme une droite de longueur infinie et d'épaisseur nulle), peuvent-elles aussi bien s'appliquer au réel, comme le montre la mathématisation progressive de toutes les sciences ? Le pythagorisme a une réponse forte à apporter, ce n'est pas pour lui que les mathématiques s'appliquent au réel, c'est que le réel est fait de mathématiques. On peut aussi postuler, comme le fait Leibniz, l'existence d'une harmonie préétablie d'origine divine, rendant d'avance notre raison apte à comprendre le monde. On peut penser qu'on reste un peu dans les deux cas à une pseudo-explication bouche-trou, destinée à occuper le vide laissé par une absence d'explication.
D'un point de vue kantien, on peut commencer par remarquer que les mathématiques ne se basant pas sur des expériences, elles dérogent aux règles normales de toute connaissance réelle. De quoi peut-on alors les tenir pour connaissance ? La géométrie est science de l'espace. Or, comme nous l'avons vu dans les chapitres sur le temps et sur la connaissance, l'espace est, selon Kant, cadre transcendantal de l'
intuition sensible. Ce qui signifie que l'espace est le cadre nécessaire et subjectif, c'est-à-dire propre au sujet percevant, par lequel il appréhende le donné. La connaissance met d'autre part en œuvre les catégories, c'est-à-dire les idées transcendantales de l'entendement. On peut donc dire que la géométrie est toute transcendantale, elle est, au sens kantien du terme, une science pure. L'autre volet des mathématiques concerne les nombres. Or ceux-ci sont succession, et la succession est l'ordre du temps. On peut donc dire que les mathématiques ne sont rien d'autre que la science pure des cadres transcendantaux, ce qui explique à la fois pourquoi elles n'ont nul besoin de l'expérience pour se constituer, et que néanmoins elles peuvent s'appliquer à toute expérience possible.
Mathématiques et problématisation
(Petit essai de vulgarisation approximative, uniquement destiné à faire soupçonner
la richesse de l'effort de problématisation des mathématiques).
Alors qu'est parfois de nos jours donnée la consigne de ne pas sanctionner un élève pour défaut de démonstration quand celle-ci n'est pas explicitement demandée, beaucoup ne soupçonnent plus très bien en quoi consiste l'activité mathématique. Certains philosophes, de leur côté, s'imaginent avoir l'exclusivité de l'effort de problématisation. Il faut donc reprendre conscience à quel point les mathématiques sont effort d'élaboration et de problématisation tout autant que la philosophie, et qu'elles ont pu, à l'occasion, aller beaucoup plus loin que cette dernière dans cette voie. Un exemple intéressant est celui de la notion d'infini, qui joue un grand rôle dans l'histoire de la philosophie et de la religion, et dont il revient aux mathématiques seules d'avoir fourni une élaboration conséquente.
L'égalité entre deux ensembles est une idée simple, quand on met en relation terme à terme les éléments de l'un avec les éléments de l'autre, ce qui exige notamment que les ensembles soient finis. Cela peut rapidement poser des problèmes, quand les éléments deviennent nombreux. La première question est à quoi reconnaît-on l'appartenance à un ensemble ( Comment distingue-t-on dans la rue un badaud d'un manifestant ?). La seconde est comment peut-on les compter (La police et les syndicats ne trouvent jamais le même nombre de manifestants). On en arrive alors à la notion d'ensemble flou, à la fois clairement définissable, mais mal dénombrable. Comment peut-on savoir qu'il y a autant d'éléments dans cet ensemble-ci que dans cet ensemble-là ? Le problème semble résolu si l'on trouve une loi de concordance qui à tout élément de l'un fasse correspondre un élément et un seul de l'autre, et réciproquement.
Cependant, cette correspondance terme à terme pose problème si l'on tente de l'appliquer à des ensembles infinis. Si l'on prend par exemple l'ensemble des entiers naturels d'une part (1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.), et celui des nombres pairs d'autre part (2, 4, 6, 8, 10, 12, etc.), la première idée qui vient est qu'il
y a deux fois moins de nombres pairs que d'entiers naturels, puisqu'on n'en prend alors qu'un sur deux. Cependant, on peut faire correspondre les deux ensembles terme à terme, (n --> p=2n et donc p -->n=p/2). On peut donc à la fois dire qu'il y a deux fois moins de nombres pairs, mais aussi qu'il y en a autant. On aurait pu aussi bien prendre les triples, les quadruples, ou ce qu'on voudra. La notion d'égalité, clairement définie pour les ensembles finis, n'est donc pas transposable dans les ensembles infinis. On utilisera donc une autre notion, celle de puissance. Notre exemple est une illustration d'un premier théorème : un ensemble a une infinité de sous-ensembles de même puissance que lui. Ce qui signifie donc que le tout peut être aussi "grand" que chacune de ses parties.
Ce qu'on appelle nombre rationnel peut être écrit soit sous forme décimale, avec des chiffres derrière la virgule qui comportent toujours une période (c'est-à-dire une séquence de chiffres qui se répète à l'infini), soit sous forme de fraction. On pourrait estimer intuitivement qu'il y a infiniment plus de nombres rationnels que de nombres entiers, puisque entre deux nombres entiers consécutifs, il y a une infinité de nombres rationnels. Or, on peut facilement montrer qu'il y en a autant. On peut en effet, en les réduisant d'abord à leur forme simplifiée (c'est à dire qu'il n'y ait plus de diviseur commun entre le dénominateur et le numérateur), les classer en adoptant deux principes, par dénominateurs croissants, puis pour ceux ayant le même dénominateur, par numérateurs croissants, en prenant soin de ne pas réécrire deux fois le même. On obtient ainsi un ordre clairement défini : 1, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 5/6, etc. Il suffit maintenant de faire correspondre 1 au premier, 2 au second, 3 au troisième, etc., pour établir une correspondance terme à terme entre l'ensemble des nombres rationnels positifs et celui des entiers naturels. Il y a donc autant des uns que des autres, les deux ensembles sont de même puissance. Or cela est tout à fait contraire à ce que nous indique notre intuition, qui nous montre les uns infiniment plus nombreux que les autres. Il y a donc ici divorce flagrant entre la raison et la sensibilité.
On obtient un résultat aussi déroutant avec les nombres réels. On peut en effet montrer qu'il y a "autant" de points dans une arête d'un cube que dans le cube lui-même. Prenons, dans un repère orthonormé (Ox, Oy, Oz), le cube formé par les trois vecteurs unitaires. Un point quelconque (P) du cube se définira par ses trois coordonnées x, y, z. Sous forme décimale, x peut s'écrire 0, x1x2x3x4x5x6x7 ....., où x1 est le chiffre des dizaines, x2 celui des centaines, x3 celui des millièmes, etc. De la même manière, y = 0, y1y2y3y4y5y6y7..... et z = 0, z1z2z3z4z5z6z7..... A ce point P on peut faire correspondre un point M du vecteur unitaire de Ox, tel que son abscisse soit m = 0, x1y1z1x2y2z2x3y3z3x4y4z4x5y5z5x6y6z6 ...... A chaque point P du volume du cube, on peut ainsi faire correspondre un et un seul point M de l'arête, et réciproquement. Il y a donc "autant" de points dans le volume du cube que sur une de ses arêtes,
ce qui totalement en opposition avec notre intuition et montre une fois de plus qu'une des parties peut être aussi grande que le tout dont elle fait partie.
On oppose classiquement infini à fini. Ce qui est fini a des limites, ce qui est infini n'en a pas. Mais en y réfléchissant, cela recouvre au moins deux situations différentes. L'ensemble des entiers naturels est infini, parce qu'on ne peut pas finir de les énumérer. L'ensemble des réels positifs est infini, parce qu'on ne peut même pas commencer de les compter (on ne peut pas dire quel est le successeur de zéro, puisque quel que soit le nombre énoncé différent de zéro, il y a entre lui et zéro une infinité de nombres réels). On peut donc appeler le premier infini dénombrable, et le second infini indénombrable. Mais il n'est pas toujours évident de décider si un ensemble est ou non dénombrable. Si on laisse les nombres rationnels dans l'ordre habituel de croissance, ils paraissent non dénombrables, puisqu'on ne peut pas dire quel est le successeur de l'un d'entre eux. Mais si on les classe comme vu ci-dessus, ils deviennent dénombrables. L'énumération n'est donc pas une propriété en soi d'un ensemble, mais d'un ensemble muni d'une loi d'ordre.
Si l'on prend l'ensemble des entiers naturels, mais en commençant par les nombres impairs, on ne change par le nombre d'éléments, mais on ne pourra jamais compter jusqu'à deux. Ces considérations interdisent de concevoir l'infini comme peuvent le faire ceux qui ne voient en cette notion qu'une quantité finie qu'on suppose variable avec possibilité de la faire croître aussi loin qu'on le voudra. C'est ce qui mènera Cantor à différencier l'infini improprement dit de l'infini proprement dit. Dans l'ordre défini ci-dessus, le nombre 2 vient après l'infinité des nombres impairs. Il n'est donc pas absurde de parler d'un nombre venant après une infinité d'autres nombres. Partant de là,
Cantor
montre qu'on peut parler par exemple du nombre qui suivrait tous les entiers naturels. Si on l'appelle ω, on peut définir ω+1, ω+2, 2ω, 3ω, etc. Mais ce faisant, on est passé à une puissance supérieure, qui est celle des nombres réels. On démontrera que ce n'est qu'avec cette nouvelle puissance qu'on pourra dénombrer l'ensemble des sous-ensembles de la puissance précédente. On pourrait l'exprimer en disant que les réels constituent un infini infiniment plus nombreux que l'infini des entiers naturels. Mais la logique adoptée pour passer des entiers naturels aux réels peut être reconduite, et permet ainsi, en partant des réels, de concevoir un infini de troisième puissance, qui formerait donc des ensembles ayant un nombre d'éléments infiniment plus nombreux que celui des nombres réels. Mais cet infini ne peut nous être donné dans la réalité, puisque, comme nous l'avons vu précédemment, un volume n'est que de la puissance des nombres réels. Cependant cette troisième puissance permettrait de dénombrer l'ensemble des sous-ensembles des points qui peuvent être donnés dans le réel. On peut ensuite passer aux puissances supérieures (appelées aleph 4, aleph 5, etc.). Ainsi, les mathématiques sont en état de construire des notions transcendant les possibilités de ce qui peut être donné.
(Pour ceux qui veulent (et qui peuvent) aborder vraiment la chose : Georg Cantor, "Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis".)
Suggestions de lectures
* Robert BLANCHÉ, L'axiomatique (P.U.F.)
* Alain BADIOU, Le nombre et les nombres.
Rubrique "à éviter"
* Sur les sujets d'épistémologie, éviter de produire des argumentations vagues ne comportant aucune référence au contenu de la science sur laquelle on disserte.
* A l'opposé (mais le risque est beaucoup plus rare), éviter de tomber dans une simple exhibition d'érudition.
Questions de révision et d'approfondissement
Pour que ces questions soient efficaces, il ne suffit pas de les survoler en se disant "ça, je saurais y répondre", ou à l'inverse "je n'y arriverai jamais". Il faut tenter d'y répondre coûte que coûte, même pas très bien, le mieux étant devant témoin (mais si...). Car c'est très différent de faire et de croire pouvoir faire. Ca peut se jouer à charge de revanche, ou encore alternativement.
* Pourquoi peut-on qualifier le pythagorisme d'état théologique des mathématiques ?
* Qu'est-ce qui peut pousser à dire, comme Galilée, que le monde est "rédigé dans une langue de mathématicien" ?
* Qu'est-ce qu'un postulat ?
* Pourquoi y a-t-il besoin d'admettre des postulats ?
* Pour quelles raisons le postulat sur les parallèles fait-il problème ?
* En quoi la découverte de Lobatchevsky diffère-t-elle de son projet initial ?
* Qu'appelle-t-on géométrie non euclidienne ?
* Le fait qu'on ne puisse pas se représenter un espace non euclidien le discrédite-t-il ?
* Quelle conception des mathématiques est mise en cause par la découverte de l'existence des systèmes non euclidiens ?
* Quelle conception de la vérité est-elle mise à mal par la découverte des systèmes non euclidiens ?
* Comment peut on penser l'existence de géométries contradictoires entre elles ?
* Qu'est-ce qu'une axiomatique ?
* Quel sens accorder à la boutade de Bertrand Russell : "Les mathématiques sont une science où on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai" ?
* Quelle différence de conception y a-t-il entre l'ancienne notion de postulat et celle moderne d'axiome ?
* Qu'est-ce que la consistance d'un système ?
* Pourquoi ne peut-on admettre de propositions contradictoires à l'intérieur d'un système ?
* Qu'est-ce qu'une proposition indécidable ?
* Qu'est-ce que l'incomplétude d'un système ?
* Ne peut-on s'interroger sur le fait que ce sont les mathématiques, et non la philosophie, qui aient établi l'existence de propositions indécidables ?
* Que Gödel a-t-il établi sur la possibilité d'autojustification d'un système ?
* Les théorèmes de Gödel ne donnent-ils pas à réfléchir sur la prétention de certains systèmes philosophiques (Hegel ou autre...) ?
* En quoi consiste la thèse empiriste de l'objet mathématique comme copie ?
* Pourquoi y a-t-il, selon Platon, différence de nature entre les deux mots dans "cinq osselets" ?
* Peut-on trouver dans la nature d'autres formes mathématiques que celle que notre culture mathématique y a mise ?
* Montrer sur deux ou trois exemples précis en quoi les objets mathématiques ne peuvent pas exister tels quels dans la réalité.
* Qu'est-ce que la conception "opératoire" des objets mathématiques ?
* Qu'appelle-t-on substantivation ?
* Qu'est-ce que le nominalisme ?
* Qu'est-ce qui explique, selon Kant, que les mathématiques puissent être une science a priori, c'est-à-dire sans expérience ?
* Qu'est-ce qui explique, selon Kant, que les mathématiques puissent s'appliquer à toute réalité ?
* La notion de problématisation peut-elle également s'appliquer à l'activité mathématique ?
* En quoi peut-on estimer que la réflexion mathématique sur l'infini est plus élaborée que celle des philosophes ?
Pour en savoir plus
* Sur le délire pythagoricien de l'an 2000, une lecture interdite aux enfants : Périnée 2000
* Sur le problème du transfini (difficile) : Georg Cantor, "Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis".
* Un exemple de recherche mathématique contemporaine (relativement facile): Benoît Mandelbrot, Les objets fractals.
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes un peu moins éducatifs, et qui néanmoins valent le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220703 |
Retour |